La RSE, nouveau récit de marque
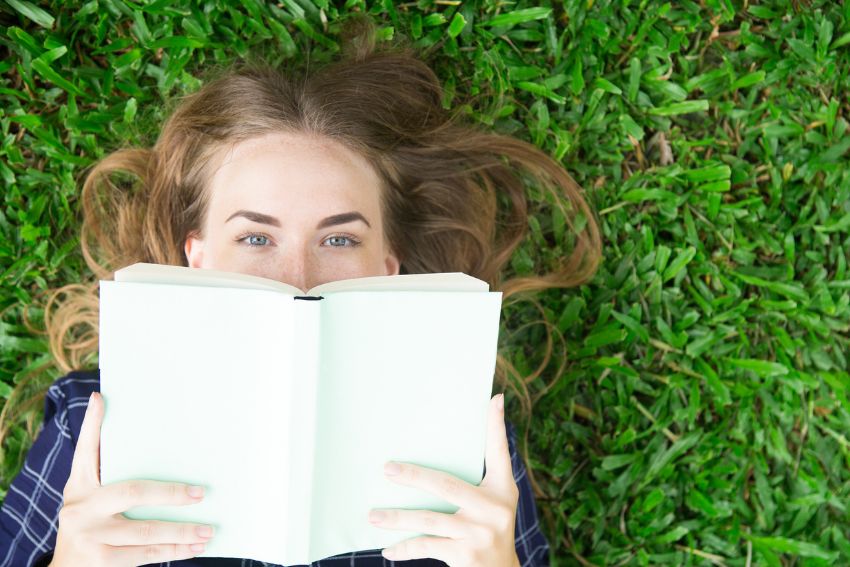
Dans un monde où la transparence devient un impératif et où l’engagement sociétal conditionne l’achat, la RSE s’impose aujourd’hui comme le cœur de la narration de marque. Cette mutation révèle une transformation profonde des rapports entre marques et consommateurs. Pour les communicants, l’enjeu n’est plus de rendre compte mais de construire un récit authentique qui résonne avec les attentes d’une société en quête de sens.
Quand la RSE réinvente les codes de la communication
Une révolution culturelle en marche
Saturés de messages publicitaires déconnectés de la réalité, les consommateurs attendent désormais des marques qu’elles s’engagent et donnent du sens à leurs achats. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Dès 2022, le baromètre Edelman Trust1 révélait que 58 % des consommateurs choisissaient une marque pour ses valeurs. L’enquête Colibris (2024)2 confirme cette tendance : 74 % des clients recommanderaient une marque engagée, 68 % consommeraient davantage ses produits. Et selon le Sustainability Sector Index de Kantar Insights (2023)3, 24 % des Français intègrent désormais les engagements RSE dans leurs décisions de consommation, un chiffre en progression constante.
De la promesse à la preuve
Mais face à aux pratiques de greenwashing et tandis que plus de la moitié des Français (51 %) déclarent avoir été confrontés à des informations trompeuses sur la RSE des marques, ils exigent désormais des preuves tangibles, plus vigilants et actifs que jamais, notamment sur les réseaux sociaux. Devant ce besoin accru de sincérité et de clarté dans les discours, le récit de marque bascule d’une logique de promesse vers une logique de preuve.
Une nouvelle grammaire narrative
La marque n’est plus uniquement identitaire, elle devient éthique, chamboulant ainsi l’approche communication. Fini le temps où l’on communiquait sur la RSE, désormais, on communique avec la RSE, elle devient le prisme à travers lequel se raconte l’entreprise. C’est un récit de transformation qui se dessine, ancré dans des actes concrets et articulé autour de preuves vérifiables.
Les secrets d’un récit RSE qui marque les esprits
L’authenticité, fondation de la confiance
Dans un environnement de communication hyperconcurrentiel, l’authenticité n’est plus un luxe mais une nécessité. L’étude Nelly Rodi (2025)4 martèle cette évidence : il faut être cohérent, transparent et sincère. Un discours perçu comme opportuniste génère immédiatement de la méfiance.
Le baromètre Cision & Club des Annonceurs (2025)5 enfonce le clou : 72 % des communicants reconnaissent que leurs publics sont hypersensibles au « washing » sous toutes ses formes. Cette hypersensibilité rend indispensable une rigueur narrative absolue qui repose sur trois piliers sans lesquels il est impossible de passer de la déclaration d’intention au récit crédible et mobilisateur.
- La preuve concrète : chiffres vérifiables, résultats mesurables, actions visibles
- L’incarnation humaine : porte-parole internes crédibles, témoignages authentiques, voix des collaborateurs
- La cohérence dans la durée : alignement permanent entre actes, valeurs et communication
L’enjeu pour les marques ? Faire ce qu’elles disent, puis le montrer avec justesse.
Le collaborateur, héros de l’authenticité
Et pour porter le discours, qui peut être plus authentique qu’un collaborateur ? Le collaborateur incarne en effet trois qualités essentielles : il est proche (il vit la réalité de l’entreprise), crédible (il n’a pas d’agenda commercial) et engagé (il porte les valeurs au quotidien). Selon une enquête Denjean & Associés6, les salariés affichent d’ailleurs l’indice de confiance le plus élevé (7,1/10), distançant largement les réseaux sociaux ou la publicité traditionnelle. Cette confiance naturelle fait du collaborateur le héros idéal des récits RSE. Portraits inspirants, journaux de bord immersifs, témoignages du quotidien : autant de formats qui transforment les discours institutionnels en histoires humaines, profondément inspirantes et renforcent simultanément la culture d’entreprise et la fierté d’appartenance.
La puissance du storytelling
Un récit RSE ne s’improvise pas, il se construit avec méthode pour transformer des engagements abstraits en histoires incarnées. Il permet à la marque de donner du sens à ses actions, de créer une résonance émotionnelle et d’impliquer durablement ses parties prenantes. Parmi les approches narratives les plus efficaces, le cinéma documentaire s’impose comme référence. Des marques comme Patagonia, Camif et Biocoop structurent brillamment leur récit autour des mêmes codes : un conflit clairement identifié, une transformation visible, une quête de sens explicite.
- Patagonia : la révolution du capitalisme régénératif
La marque californienne a bâti son récit sur un paradoxe assumé : lutter contre la surconsommation tout en vendant des produits. Yvon Chouinard, le fondateur, a mené une transformation radicale qui a culminé en 2022 quand il a cédé son entreprise à une fondation environnementale, concrétisant le slogan « We’re in business to save our home planet »7.
Les formats adoptés dans la communication de la marque empruntent directement aux codes du documentaire : témoignages de terrain dans Blue Heart8ou Public Trust,9 voix off sobre, esthétique naturaliste, … Patagonia documente son combat.
- Camif : la renaissance par l’engagement
L’ancienne entreprise de vente par correspondance a reconstruit son identité post-faillite sur trois piliers : relance de la production locale, transparence radicale et abandon symbolique du Black Friday depuis 201710.
La marque s’est donné pour mission de « réinventer la maison au service de l’Homme et de la planète ». Ses vidéos institutionnelles, portées par le dirigeant Emery Jacquillat qui a cédé sa place en 2025 à Julien Chaverou,11 adoptent les codes du documentaire corporate engagé : formats longs, voix off, immersion dans les usines locales, témoignages de salariés et partenaires. Résultat : une croissance à deux chiffres et une clientèle renouvelée à 80 %.
- Biocoop : l’engagement militant assumé
La coopérative a construit son récit sur la rupture avec la grande distribution traditionnelle. Ses décisions audacieuses (pas de fraises en hiver, produits d’origine France, refus de l’eau en bouteille) traduisent une volonté d’être « plus qu’un commerçant, un acteur de la transition écologique et solidaire ».
Longtemps activistes12 et parfois même sanctionnées13, les campagnes de Biocoop évoluent vers un ton plus optimiste en 202514 (« Dire NON aux pesticides, c’est dire OUI à la biodiversité »15). La narration adopte les codes du documentaire militant : témoignages d’agriculteurs, extraits de réunions coopératives, formats immersifs qui renforcent l’engagement coopératif et citoyen.
Le succès de ces trois marques tient au fait qu’elles maîtrisent la même recette narrative et partagent une quête de sens crédible et mobilisatrice. Le public n’assiste pas à une campagne publicitaire, il suit une histoire en mouvement.
Faire de la RSE le cœur de la plateforme de marque
De la stratégie à l’intégration narrative
La RSE doit devenir le socle narratif de la plateforme de marque. Cette transformation exige l’articulation de trois dimensions complémentaires :
- Une stratégie RSE structurée: claire et alignée sur les enjeux ESG (environnementaux, sociaux, de gouvernance).
- Une plateforme de marque actualisée: intégrant raison d’être, engagements et preuves concrètes.
- Une architecture narrative maîtrisée: définissant qui parle, à qui, avec quels formats, sur quels canaux, selon quelle temporalité.
Cette intégration passe par quatre étapes méthodologiques : l’audit narratif (inventaire des récits existants), la hiérarchisation des preuves (ce que la marque fait vraiment), l’alignement stratégique (cohérence entre promesse et actions), et la mise en récit (choix des formats et moments clés).
Cette approche transforme ainsi la RSE en véritable moteur créatif et stratégique. Fini les opérations de façade : place à un engagement vivant qui nourrit authentiquement l’identité de marque.
Le communicant, chef d’orchestre de la transformation
Dans ce contexte, le directeur de la communication occupe désormais une position stratégique au carrefour des attentes internes (RH, salariés, gouvernance) et externes (clients, partenaires, médias, citoyens). Il devient le garant de la cohérence entre stratégie, discours et preuve, tout en orchestrant le récit de marque responsable.
Il doit à la fois traduire la stratégie RSE en récits mobilisateurs, compréhensibles et activables sur les bons canaux ; fédérer les parties prenantes internes, du comité exécutif aux collaborateurs terrain, autour d’un langage commun et d’un engagement partagé ; assurer la transversalité éditoriale, en alignant les messages entre les différentes équipes (RSE, RH, marketing, communication produit,…) ; et arbitrer entre storytelling inspirant et sincérité radicale.
Cette posture exige vision stratégique, maîtrise des formats narratifs, capacité pédagogique et courage politique. Le communicant devient ainsi un médiateur de confiance.
Les écueils du récit RSE
La construction d’un récit RSE peut rapidement se retourner contre la marque si elle n’est pas rigoureusement pensée et incarnée. Quatre écueils majeurs menacent les communicants :
- Le greenwashing narratif : raconter sans démontrer, embellir les engagements, valoriser des actions symboliques sans ancrage réel.
Cette approche détruit la confiance et expose la marque à des critiques publiques, voire à des sanctions légales, pouvant même générer des situations de crise. Selon une étude de l’ADEME (2023)16 près de 40 % des publicités en France présentant un caractère écologique seraient jugées trompeuses ou excessives16.
- L’incohérence interne/externe : afficher des valeurs RSE dans les campagnes alors que la culture d’entreprise, les pratiques managériales ou les processus industriels contredisent ces valeurs.
L’alignement des actes et du discours conditionne la crédibilité.
- La surcommunication institutionnelle : multiplier les messages normatifs ou formatés, au détriment de l’authenticité.
Le récit devient figé, désincarné, incapable de susciter l’adhésion émotionnelle.
- Le court-termisme narratif : vouloir créer une campagne RSE ponctuelle sans s’inscrire dans une temporalité durable.
Un récit responsable se construit dans la continuité, la preuve et l’écoute, pas dans l’effet d’annonce.
Plusieurs exemples17 récents illustrent les risques liés à ces dérives. TotalEnergies a été vivement critiquée pour avoir mis en avant ses investissements dans les énergies renouvelables tout en poursuivant ses activités fossiles à grande échelle. H&M France et Decathlon ont été accusés de greenwashing en valorisant des gammes prétendument « éco-conçues » sans fournir de preuves suffisantes. Dans l’alimentaire, Danone, Auchan et Carrefour18 ont fait l’objet d’une mise en demeure par des ONG pour ne pas avoir publié de plans de vigilance satisfaisants sur l’usage du plastique, malgré leurs discours responsables.
Ces différents cas rappellent que la communication RSE doit penser son récit comme une démarche exigeante et systémique, qui résiste à la tentation du superficiel.
Quand la loi impose la transparence
La CSRD19 (Corporate Sustainability Reporting Directive), en vigueur depuis janvier 2024, impose aux grandes entreprises européennes un reporting extra-financier standardisé et vérifié, transformant la communication RSE en exercice de transparence exigeant.
La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 interdit toute allégation environnementale trompeuse et oblige les marques à documenter scientifiquement leurs arguments écologiques, sous peine de sanctions.
Pour les communicants, cela signifie maîtriser les référentiels réglementaires, garantir la traçabilité des messages et travailler en collaboration étroite avec les équipes juridiques et RSE. C’est le socle légal de toute prise de parole responsable.
L’avènement du récit à impact
Une évidence s’impose : nous assistons à une refondation profonde de la communication d’entreprise. La RSE constitue désormais le fondement d’un récit à impact qui parle à tous avec la même force. Place à l’art du récit conjugué à la rigueur de la preuve, aux engagements racontés dans des histoires simples et mémorables. Dans un monde où les consommateurs en quête de sens, achètent désormais autant une histoire qu’un produit, autant des valeurs qu’un service, l‘avenir appartient aux marques qui savent raconter leur impact.
Sources :
- Étude Kantar, Baromètre Edelman Trust (2022
- Enquête Colibris (2024)
- Sustainability Sector Index – Kantar Insights (2023)
- NellyRodi (2025)
- Baromètre Cision & Club des Annonceurs (2025) –
- Enquête Denjean & Associés (février 2018)
- https://www.nationalgeographic.fr/environnement/natgeo33/yvon-chouinard-fondateur-de-patagonia-a-cede-son-entreprise-pour-sauver-la-planete
- Blue Heart
- Public Trust
- CAMIF prend le contrepied de Black Friday
- Novethic – environnement
- Biocoop – Campagnes
- Biocoop – dénigrement du non bio
- Campagne de marque – Biocoop
- La bio nouvelle génération, un grand OUI !
- Publicité et environnement
- Greenwashing : pourquoi les marques se font épingler (et comment l’éviter)
- Pollution plastique: Auchan, Carrefour, Casino, Danone, Lactalis mis en demeure par des ONG
- Directive CSRD
- Loi Climat & Résilience
